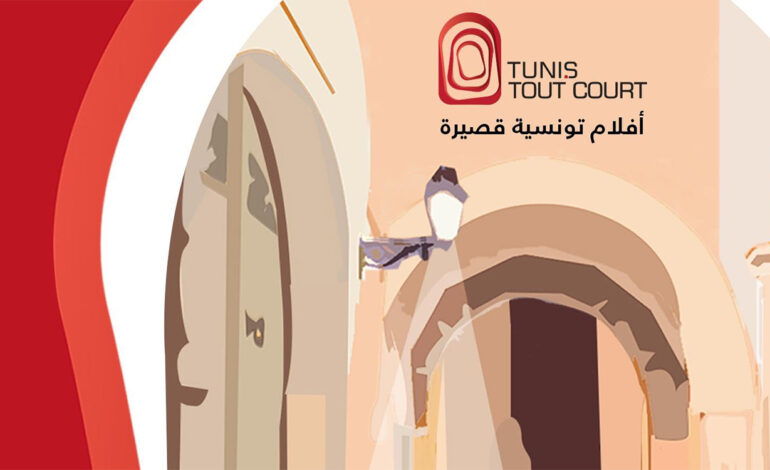La littérature, les arts visuels, le cinéma ont été, depuis lors, au service de l’humanité, un véritable rempart contre l’oubli, contre le mensonge et les falsifications. Penser esthétiquement le réel afin de panser les plaies, ne serait-ce que moralement, est une preuve tangible de l’engagement de l’artiste à l’égard des causes humaines.
Nous nous étions tous réjouis quant à la bonne nouvelle du film «The voice of Hind Rajeb» de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania. Impatients, le désir attisé de découvrir cette œuvre cinématographique qui a su attirer de fameux producteurs occidentaux et qui a été primée à la Mostra de Venise lors de sa première mondiale, en obtenant le Lion d’argent, prestigieuse distinction d’un festival de renommée en plus des prix parallèles.
Ardemment curieux donc, nous étions au cinéma Le Colisée le 12 septembre, lors de la projection destinée aux journalistes. Hélas ! Juste après la projection, la ferveur s’est éteinte et la déception a pris place, en se disant que ce film ne pourrait malheureusement se classer parmi les grandes œuvres de l’histoire, telles que «Guernica» de Pablo Picasso, «Les Horreurs de la guerre» de Rubens ou encore des films qui ont abordé les bombardements et les génocides, sans lever la barre au chef-d’œuvre de Francis Coppola «Apocalypse Now». Bref !
Incrimination ou compassion ?!
Le film se classe dans la catégorie docu-fiction. Il reprend la destinée tragique de la petite fille palestinienne Hind Rajeb qui, unique survivante parmi les cadavres de sa famille, appelle en vain à son secours et finit par mourir après de longues heures d’attente, assassinée par 355 tirs de l’armée sioniste.
La tragédie de l’enfant Hind Rajab, parmi tant d’autres actes atroces, atteignait le summum de la monstruosité sioniste. Élaborer, en effet, des œuvres cinématographiques sur le réel de Gaza et de Palestine est un devoir étique, une nécessité historique, de l’engagement humain. Le moins qu’on puisse faire, c’est de transposer sur l’écran les horreurs de cet occupant criminel de manière responsable, claire, directe, tranchante.
Le cinéma est l’art le plus puissant, le plus influant et le plus concret à jouer un rôle déterminant conscientisant le monde occidental silencieux, lui montrant sa défaillance envers la cause palestinienne et braquant la caméra sur la décrépitude des valeurs universelles. Il ne s’agit nullement de susciter sa compassion, réclamer sa pitié, mais plutôt développer une conscience critique face à ce qui se passe à Gaza !
Le film «The voice of Hind Rajeb» de Kaouther Ben Hania a joué sur l’affect du public au détriment de son intellect, il s’est contenté d’offrir une séance cathartique en versant tant de larmes et a évité toute tentative directe et concrète d’incrimination de l’occupant sioniste. S’adresser à l’opinion occidentale ne consiste pas à faire émouvoir et à provoquer l’empathie, mais à s’indigner, à dénoncer le génocide en remettant en cause le silence et l’avilissement des valeurs humaines.
Les réseaux sociaux ont bien joué leurs rôles en propageant les informations et en touchant un large public par rapport à ce qui se passe. Quant à l’artiste, il se dote d’une responsabilité plus profonde, plus consciente et plus déterminante. Il est appelé à livrer une approche cinématographique, une vision esthétique pensante, poussant à l’interrogation, stimulant la réflexion, disséquant les structures du pouvoir de l’occupant sioniste et poussant à agir afin d’aboutir au changement positif.
L’ombre d’une autocensure
Ce film «The voice of Hind Rajeb» a focalisé sur deux facteurs : d’abord, il a braqué la lumière sur les obstacles intérieurs liés au centre du Croissant-Rouge Palestinien, aux complications des démarches administratives et des problèmes de coordination entre les cellules intervenantes qui ont entravé le dépêchement des secouristes.
Ensuite, il a remis en question les conflits entre les palestiniens eux-mêmes à travers le désaccord entre Amr, qui espérait sauver la fille à tout prix, et son supérieur le chef du centre, Mahdi, qui se trouvait soumis aux exigences des protocoles du Croissant-Rouge, afin d’éviter le risque de perdre des secouristes.
Le désaccord s’intensifiait au point que ces derniers se lancent des accusations. Ces deux facteurs ont, à mon sens, dominé le film et ont relégué la source du mal — l’entité sioniste — au second plan. Ceci a, par la suite, orienté l’attention du spectateur et a détourné le regard du génocide et des monstruosités sionistes. D’ailleurs, on ne nous montre pas la dévastation et le ravage à l’extérieur que très peu à la fin sans dépasser les quelques secondes, très vite on renoue avec le témoignage de la mère de Hind.
De ce fait, on sent comme si ce film était pré-orienté par les producteurs occidentaux, ou peut-être une autocensure de la réalisatrice à travers son choix d’un espace intérieur fermé comme lieu d’actions, pour garantir peut-être les subventions et la sollicitation des festivals internationaux. (l’autocensure est plus grave que la censure extérieure). Bref, que ce soit de bonne ou de mauvaise foi, on pressent l’ombre d’une certaine manipulation politique et un détournement du regard de la monstruosité de l’occupant sioniste.
Le cinéma, c’est d’abord l’image!
Hormis les sensations de pression, de stress, d’effondrement en pleurs, que reste-t-il du film ? Que garde-t-on après la projection ? Presque rien ! Mais le cinéma c’est d’abord l’image, le canevas, la grande narration, le jeu d’acteurs, les belles prises et l’expression de la caméra, le rythme, la vision créative du réalisateur… Je crois qu’il n’y a rien d’exceptionnel dans ce film, excepté la voix tragique de Hind Rajeb qui résonnait en nous depuis qu’on l’avait écoutée le jour même de sa tragédie sur les réseaux sociaux.
En toute franchise, le scénario est si simple qu’il s’apparente à un documentaire sonore d’autant plus qu’il est basé sur des enregistrements audios de la voix de Hind. Donc, sur le plan de l’approche cinématographique, le film est bien modeste.
Ce qui a touché le public, c’est la tragédie de l’enfant Hind, ce ne sont pas les qualités esthétiques du film. C’est en terme de solidarité que le film a attiré plusieurs producteurs de renommée internationale, soit pour marquer une position ou pour un rendement mercantile, vu le changement de l’opinion publique des peuples occidentaux quant à la question de Gaza. C’est pour cela que le film a été ovationné pendant 23 minutes lors de sa première mondiale, ce qui est bien naturel, et a décroché le prestigieux Lion d’argent de la Mostra de Venise !?…