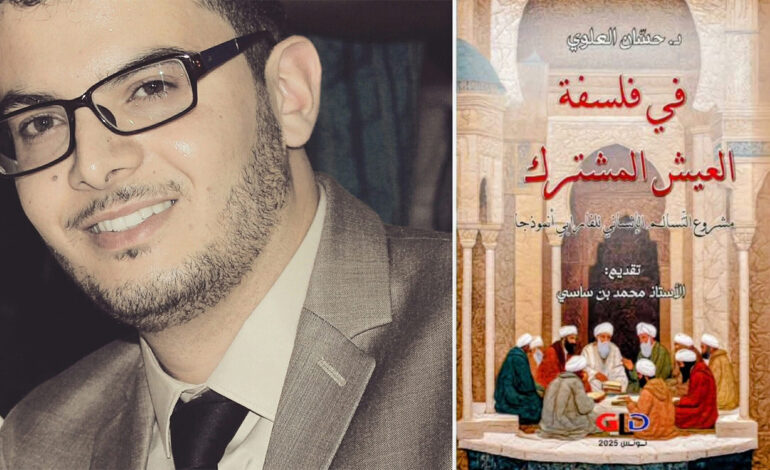Présentation de « Harems et Sultans » de Jocelyne Dakhlia à l’IRMC : Les stéréotypes à l’épreuve de l’histoire

À travers cet ouvrage où questions de genre et politique s’entremêlent, Jocelyne Dakhlia entend répondre à ce qu’elle appelle les « pathologisations de l’histoire ».
La Presse — L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (Irmc) a accueilli le 6 novembre la présentation du dernier ouvrage de l’historienne et anthropologue Jocelyne Dakhlia, intitulé « Harems et sultans. Genre et despotisme au Maroc et ailleurs, XIVe–XXe siècle ».
D’origine franco-tunisienne, Jocelyne Dakhlia est spécialiste de l’histoire politique du Maghreb et, plus largement, de la Méditerranée. Elle est directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (Ehess) et autrice de nombreux ouvrages transdisciplinaires, parmi lesquels « Islamicités » et « Tunisie. Le pays sans bruit ».
La discussion a été modérée par l’historienne Fatma Ben Slimane, professeure à la faculté des Sciences humaines et sociales de Tunis (Fshs).
La genèse de l’ouvrage
Paru en trois volumes aux éditions Anacharsis, cet ouvrage traite de l’histoire politique et sociale des sultans du Maroc, en la comparant constamment à celle d’autres espaces du monde islamique, de la Chine, de l’Europe, notamment des empires espagnol et portugais ainsi que d’autres régions du globe.
Sa vocation essentielle, comme l’a indiqué l’autrice, est de déconstruire le mythe orientaliste du despotisme et du harem comme lieu d’intrigues féminines, de manipulations politiques et de rivalités amoureuses.
Le titre, que Jocelyne Dakhlia qualifie de « provocation », est un choix éditorial assumé, né de la confiance de son éditeur dans la portée de ce travail de recherche.
L’écrivaine a raconté la genèse de cet ouvrage de plus de mille pages. Le déclencheur en fut la lecture des mémoires d’un captif français au Maroc au XVIIe siècle.
En 1672, le sultan part en expédition nocturne, alors qu’il neigeait, pour retrouver des alliés dans la montagne. Une de ses femmes s’y perd et ne sera jamais retrouvée.
Ce récit révèle que les femmes n’étaient pas confinées, contrairement à la légende. Elles voyageaient, parfois au péril de leur vie. Ce ne sont pas de simples « corps statistiques ». La disparition d’une femme mobilise ici l’attention du pouvoir, ce qui montre que la vie d’une seule femme compte.
Ce fait amène également à reconsidérer la nature du pouvoir sultanien et à contester nos préjugés sur le despotisme. À cette époque, la qualité du gouvernement se mesurait à l’état et à la sécurité des routes, garants de la stabilité du royaume.
La présence des femmes sur les routes et leur droit à se déplacer s’opposent donc au cliché d’un despotisme clos et oppressif où les femmes seraient asservies, opprimées dans une société déjà dysfonctionelle. C’est une structure mobile. Le sultan lui-même ne mène pas une vie sédentaire. Il doit se battre, s’exposer, être vaincu ou vainqueur, loin de l’image du monarque isolé tandis que femmes et eunuques trameraient dans l’ombre.
Fatma Ben Slimane a rappelé, à ce propos, que le célèbre feuilleton turc « Harim al sultan » s’intitulait à l’origine « Le siècle magnifique », avant que le titre ne soit modifié pour s’aligner sur l’imaginaire orientaliste du harem.
Déconstruire les « pathologisations de l’histoire »
À travers cet ouvrage où questions de genre et politique s’entremêlent, Jocelyne Dakhlia entend répondre à ce qu’elle appelle les « pathologisations de l’histoire ».
La question des femmes a souvent servi de prétexte à une mise à distance des sociétés musulmanes et, in fine, à la justification de la colonisation au nom d’une supposée mauvaise gouvernance. Selon l’autrice, les crises contemporaines autour de l’islam ont ravivé une curiosité scientifique et suscité une multiplication des recherches. Toutefois, le renouvellement de la pensée historique de ces dernières décennies peine encore à se refléter dans les débats publics.
D’où la nécessité de remettre en question les grands topoï historiques pour rendre justice à ces travaux.
Jocelyne Dakhlia reprend ainsi le dossier des harems en inscrivant les problématiques dans leur contemporanéité. Elle part des préjugés orientalistes, souvent intériorisés, pour déconstruire une double fiction : celle du despotisme et celle du harem.
Son travail repose sur une démonstration rigoureuse appuyée par une abondance de sources et de notes dans un manuscrit de 2400 pages immédiatement accepté par son éditeur.
« Cette vision d’une société en panne est dépassée par les recherches historiques. Tout peut être repris à la base. Nous devons déminer le terrain, initier les questionnements au lieu de continuer à les subir, répondre en nuançant, loin de toute empathie coupable », souligne-t-elle.
Repenser les images et les représentations
L’autrice s’est également attardée sur le rôle des images médiatiques, souvent plus percutantes que les textes, dans la reproduction des stéréotypes historiques.
Le contenu stéréotypé nourri par les clichés orientalistes foisonne sur le web et demeure facilement accessible lors des recherches, alors même qu’il s’écarte totalement des vérités historiques. Jocelyne Dakhlia a d’ailleurs montré, à titre d’anecdote, des images qu’une grande chaîne de télévision avait utilisées pour annoncer la présentation de son livre alors qu’elles véhiculent précisément l’opposé du propos qu’elle y défend. Elle a donc appelé à développer une nouvelle iconographie afin de restaurer la dignité des acteurs historiques et de proposer un autre regard sur les sociétés musulmanes.
Cette relecture critique de l’histoire, fondée sur la preuve et le croisement des sources, vise à corriger la manière dont le regard occidental décrit les sociétés du Maghreb.
En partant du Maroc pour élargir son analyse à d’autres contextes, Jocelyne Dakhlia livre une œuvre que le public de l’Irmc a jugée remarquable par son innovation, son engagement et sa minutie.