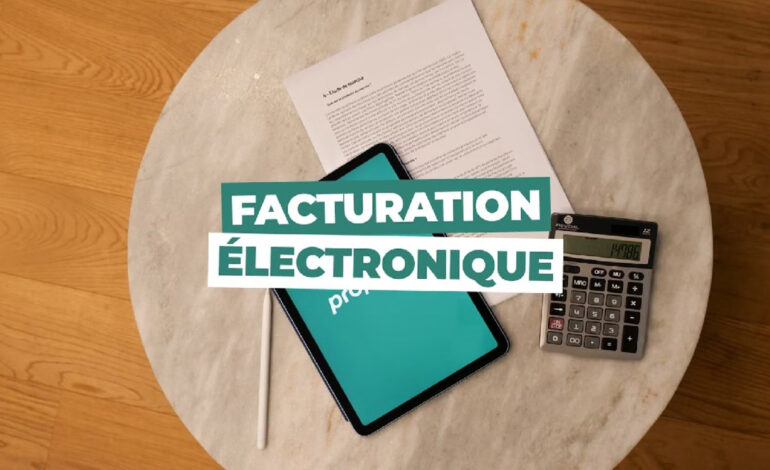Abolition de l’esclavage et réformes d’État : Repenser l’exception tunisienne

Parler d’« exception tunisienne » n’est jamais neutre. C’est par cette mise en garde méthodologique que le professeur émérite à la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, Abdelhamid Henia, a ouvert une conférence consacrée aux grandes réformes engagées en Tunisie entre 1840 et la fin du gouvernement Kheireddine Pacha (Ettounsi), ce mercredi 4 février à Beit al-Hikma à Carthage.
Une période charnière souvent interprétée, dans l’historiographie, comme le simple produit de pressions étrangères.
La Presse — D’emblée, le conférencier assume sa posture, celle d’un historien conscient de sa subjectivité, mais soucieux de la maîtriser. «Avouer sa subjectivité permet de la contrôler», souligne-t-il, préférant parler de réalités historiques concrètes plutôt que d’une objectivité abstraite. L’enjeu est clair, dépasser une lecture réductrice qui ferait des réformes tunisiennes du XIXe siècle une conséquence mécanique de l’intervention des puissances européennes.
France, Empire ottoman et Grande-Bretagne : des influences à relativiser
À partir de 1840, la Tunisie connaît une série de réformes politiques, administratives, fiscales et juridiques qui transforment en profondeur les structures de l’État. Ces transformations ont été largement étudiées par des chercheurs tunisiens et étrangers.
Un consensus relatif s’est toutefois imposé. En effet, et selon certains historiens, l’abolition de l’esclavage en 1846, le Pacte fondamental de 1857 ou encore la Constitution de 1861 seraient essentiellement le résultat de pressions britanniques, françaises ou ottomanes.
La présence de la flotte française à La Goulette lors de la proclamation du Pacte fondamental, ou l’influence supposée du consul britannique dans l’abolition de l’esclavage, sont souvent citées comme preuves. Mais cette interprétation, estime le conférencier, pose un problème majeur car elle évacue le rôle des acteurs tunisiens et suggère une société incapable de produire ses propres dynamiques de changement.
L’analyse détaillée des rapports avec les puissances étrangères invite pourtant à la nuance. Concernant la France, l’argument de la pression abolitionniste ne résiste pas à l’examen des faits puisque Paris n’abolit définitivement l’esclavage qu’en 1848, soit deux ans après la Tunisie. Mieux encore, des documents attestent d’une hostilité française à certaines mesures tunisiennes entravant le commerce des esclaves.
Du côté de l’Empire ottoman, la chronologie est tout aussi révélatrice. L’abolition de l’esclavage y intervient en 1850, et la Constitution ottomane en 1876, bien après celles de la Tunisie. Ces décalages temporels interrogent l’idée d’un modèle imposé par Istanbul.
Quant à la Grande-Bretagne, son rôle dans l’abolition de l’esclavage est réel, puisque celle-ci intervient en 1833, mais il s’inscrit avant tout dans une logique économique liée à la révolution industrielle. Les mesures progressives prises par Ahmed Bey entre 1841 et 1846 relèvent ainsi d’une stratégie diplomatique pragmatique visant à obtenir le soutien britannique face aux ambitions ottomanes et françaises, et non d’une capitulation sous pression.
Une dynamique interne marquée par le passage du concept de « beylik » à celui d’« État ».
Pour le conférencier, parler de « réformes imposées par les consuls européens » relève d’une lecture européocentriste, qui nie l’existence d’une dynamique interne tunisienne. Les réformateurs, influencés certes par l’Occident, ne se contentent pas d’importer ou copier des modèles. Ils les réinventent, les adaptent et les inscrivent dans un contexte local marqué par des résistances sociales et religieuses.
Cette capacité d’appropriation apparaît également dans le discours réformiste. À partir de 1840, la Tunisie connaît une véritable rupture épistémologique avec l’émergence de nouvelles catégories politiques et de nouveaux usages linguistiques, marquée notamment par le passage du concept de «beylik » à celui d’« État ». Les réformes ne sont plus conçues comme un devoir religieux, mais comme une nécessité politique.
Fait notable, dévoile le conférencier, les réformistes tunisiens ne revendiquent aucune réforme religieuse. Leur priorité va aux domaines militaire, administratif, éducatif, social et législatif. « L’islah » devient un outil de survie politique, et non un projet théologique. Cette approche séculière marquera durablement l’élite tunisienne, du mouvement national jusqu’à l’après-indépendance.
Dès lors, la question de l’exception tunisienne ne peut être évacuée. Les réformateurs de la seconde moitié du XIXe siècle se percevaient eux-mêmes comme à l’avant-garde du monde arabo-musulman, voire en avance sur certaines puissances occidentales, notamment en matière d’abolition de l’esclavage.
Repenser l’exception tunisienne
Loin d’être un simple produit de contraintes extérieures, le projet réformateur porté par Ahmed Bey et poursuivi par Kheireddine Pacha apparaît comme un acte fondateur d’une nouvelle modernité tunisienne, visant à renforcer la souveraineté du pays face aux défis économiques et géopolitiques.
Repenser l’exception tunisienne, conclut le conférencier, ce n’est pas céder à une fierté nationale excessive, mais reconnaître une trajectoire historique singulière, façonnée par des choix internes, une conscience politique affirmée et une volonté assumée d’être à l’avant-garde.La conférence s’est achevée par la projection du film «La liberté en acte», du réalisateur Hichem Ben Ammar.
Le documentaire revient sur un moment fondateur de l’histoire tunisienne à savoir l’abolition officielle de l’esclavage en 1846, faisant de la Tunisie le premier pays du monde arabo-musulman à franchir ce pas décisif.
À travers une écriture cinématographique sobre et sensible, le film convoque images d’archives, peintures, gravures, cartes animées et voix contemporaines pour redonner corps à une histoire longtemps reléguée aux marges de la mémoire collective. «La liberté en acte» interroge les ressorts politiques, économiques et théologiques de cette abolition pionnière, tout en donnant la parole aux figures oubliées, aux résistances silencieuses et aux héritages encore vivants.
Entre rigueur historique et poésie visuelle, l’œuvre éclaire une page méconnue de l’histoire tunisienne et l’inscrit dans une réflexion universelle sur la liberté, la dignité humaine durant l’époque coloniale, et le devoir de mémoire.