Culture : la part invisible de notre souveraineté
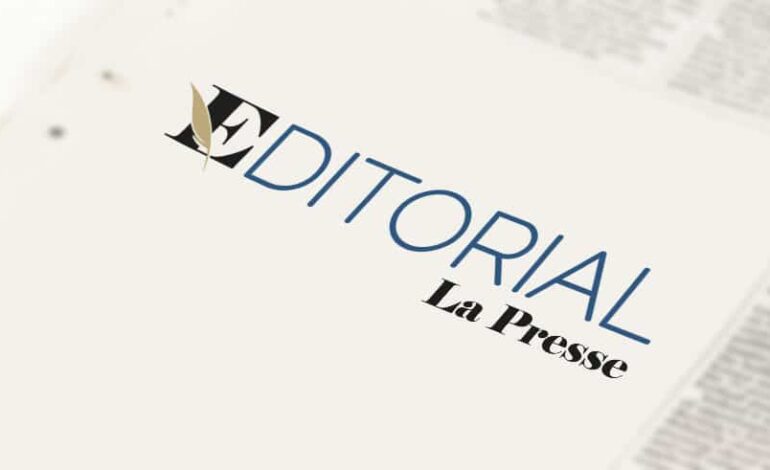
A travers la présentation du projet de budget 2026 du ministère des Affaires culturelles, nous relevons une vision structurée, articulée, nourrie de bonnes intentions et, surtout, replacée dans l’horizon stratégique d’un État qui entend redonner à la culture sa fonction matricielle. Car il faut le rappeler avec force : les défis culturels ne sont pas des ornements protocolaires ; ils constituent le cœur pulsatile de toute nation qui aspire à demeurer fidèle à elle-même.
L’audition de la ministre Amina Srarfi devant les deux Commissions parlementaires aura eu le mérite de sortir la culture de son angle mort budgétaire. Une hausse de 8% — certes encore modeste au regard des ambitions — révèle pourtant un sursaut, un début de reconnaissance de la culture comme levier de développement et non plus comme une simple périphérie esthétique de l’action publique.
La vision ministérielle repose sur cinq piliers : valorisation économique, protection du patrimoine, création et participation, rayonnement culturel, modernisation administrative. Une architecture cohérente qui tente de concilier deux temporalités souvent contradictoires : l’urgence du présent, où l’économie culturelle doit s’intégrer au tissu productif, et le long cours, où la préservation du patrimoine reste un acte de vigilance civilisationnelle.
Que les industries culturelles puissent, à terme, contribuer à hauteur de 3 % du PIB relève d’une ambition lucide. L’augmentation du plafond de garantie pour les industries créatives — de 90.000 à 300.000 dinars — constitue un geste tangible pour catalyser l’émergence de près de 200 startups. Or, investir dans une startup culturelle, c’est investir dans une idée, un style, une manière d’être au monde, donc dans l’identité nationale.
Mais l’enjeu majeur réside ailleurs : dans la numérisation et la préservation du patrimoine, dans l’assainissement des archives, dans la création d’un office national du patrimoine qui rassemble ce qui fut trop longtemps dispersé. Car un pays qui ne garde pas la trace de ce qu’il fut finit toujours par ignorer ce qu’il est.
La ministre évoque la culture comme « acteur efficace du développement global ». Permettons-nous d’aller plus loin : la culture est l’ossature invisible de la souveraineté. Elle ne produit pas seulement des œuvres, elle produit du sens.
Et si la Tunisie veut bâtir son avenir, il faudra qu’elle commence par préserver ce que personne ne pourra jamais lui emprunter : sa voix, sa mémoire, son identité.



